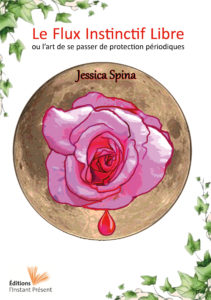Un livre pour réfléchir sur le soin porté à autrui
Lu hier dans le Monde, cet article au titre claquant « Européennes, diplômées et femmes au foyer » (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/03/europeennes-diplomees-et-femmes-au-foyer_1742099_3232.html).
Il est signé de Birgitta Ohlsson, ministre suédoise des affaires européennes et, précise complaisamment Le Monde membre des « Jeunes dirigeants du monde 2012 désignés par le Forum économique mondial ».
La sobriété du titre de cet article souligne paradoxalement l’anormalité de cette situation, « femmes au foyer » et « diplômées », du moins aux yeux de cette femme politique. Si les inégalités salariales entre hommes et femmes, ou la part dérisoire de femmes ayant des responsabilités politiques sont des problèmes réels, et de vraies luttes encore à mener, l’approche purement capitaliste du reste de la démonstration fait froid dans le dos : car en effet, « 76 % des hommes, en moyenne, sont présents sur le marché du travail tandis que les femmes ne le sont qu’à hauteur de 62 % ». Et, d’après « un rapport de recherche, publié par l’université d’Umeå (Suède), (…), si les femmes étaient aussi nombreuses que les hommes sur le marché du travail, le revenu national brut de l’Union Européenne pourrait augmenter de 27 %. » Que ne se jette-on pas sur cette possibilité d’ augmentation si désirable du « revenu national brut de l’Union Européenne », en effet ?
Mais les empêcheurs d’augmentation des revenus sont toujours les mêmes : les enfants, et les personnes âgées, auxquels les femmes consacrent un temps et des « compétences » qui ainsi « ne sont pas mises à profit » (car bien sûr, mettre des compétences acquises à travers une formation universitaire au service de ses proches, de son développement personnel, ne profite pas au PIB, et n’est donc pas mis à profit.)
Birgitta Ohlsson a heureusement réfléchi à des solutions : tout d’abord, « un accueil de qualité ne doit pas être un privilège mais un service auquel tout parent doit avoir accès. Il doit être rentable de travailler, même après avoir eu des enfants. Voilà pourquoi le coût de l’accueil de l’enfance doit être subventionné ou déductible. »
Plusieurs commentaires ici : la rentabilité ne se conçoit bien sûr que financièrement, il n’est pas question de la fatigue ou de la distance affective, qui ont pourtant bel et bien un coût. Les subventions ou la déductibilité sont d’ailleurs des coûts, et il est inquiétant qu’une personne qualifiée de « jeune dirigeant du monde » ne s’en aperçoive pas : des services de garde « de qualité » ont un coût sans commune mesure avec une garde familiale, et ce coût devra bien être assumé par quelqu’un. L’Etat, c’est-à-dire les citoyens, parents ou pas ? Les entreprises, au détriment donc de leur compétitivité, ou des salaires des employés, les obligeant à travailler plus pour que leur travail soit rentable, et donc accroissant leurs besoins de garde, donc leurs coûts, et… ? Et encore, il ne s’agit que d’un raisonnement économique, faisant abstraction des coûts affectifs de cette situation.
De la même façon, s’insurge, Birgitta Ohlsson, « l’assistance aux personnes âgées devrait être améliorée et renforcée. Aujourd’hui, il est fréquent que des femmes aient la responsabilité de la prise en charge, bénévole, de leurs parents. » Qui va prendre en charge cette assistance, physiquement et émotionnellement difficile ? A quel coût, pour qu’elle soit de qualité ? Et qui va payer, une nouvelle fois ?
Ces déclarations d’intention relèvent entièrement du genre bureaucratique ; on a envie de renvoyer Birgitta Ohlsson aux travaux pionniers des sociologues américaines du care (pour une première approche du sujet, voir Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, de Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, Payot, 2009) pour qu’elle ait une chance de comprendre ce que recouvre réellement la dimension de la prise en charge des personnes faibles et dépendantes.
Car si les femmes diplômées participent à l’escalade économique au même titre que les hommes (alors que tous devraient plutôt chercher à en sortir), il faudra bien que d’autres se chargent de leurs tâches familiales : d’autres femmes, moins diplômées forcément, immigrées peut-être (la famille de ces femmes étant ainsi privée de leur présence…), rendant ainsi fort compliquée la prise en charge de qualité. Birgitta Ohlsson ne semble pas voir en effet que la qualité relationnelle est une compétence de haut niveau, encore plus quand elle doit être mise en œuvre face à des personnes étrangères sur le plan affectif. Elle ne s’impose pas d’un décret européen, fût-ce au nom des impératifs de croissance.
Enfin, la proposition d’une imposition individuelle, pour empêcher les femmes de « dépendre » du père de leurs enfants, est aussi une attaque envers les liens que les personnes peuvent vouloir créer entre elles, là où la réalité des besoins humains refuse de céder, toujours elle, à la « rationalité » des contraintes économiques.
Si le féminisme, c’est se soumettre à des valeurs uniquement marchandes, alors c’est échanger une servitude contre une autre. C’est un meilleur partage du soin qu’il faut viser, pas un meilleur partage d’une lutte économique absurde et destructrice.
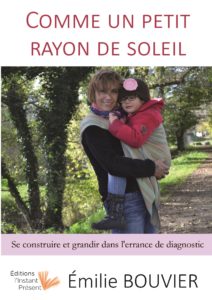 Vous pouvez demander l’option emballage cadeau sur notre site pour le faire parvenir directement à la personne à qui vous souhaitez offrir le livre.
Vous pouvez demander l’option emballage cadeau sur notre site pour le faire parvenir directement à la personne à qui vous souhaitez offrir le livre.